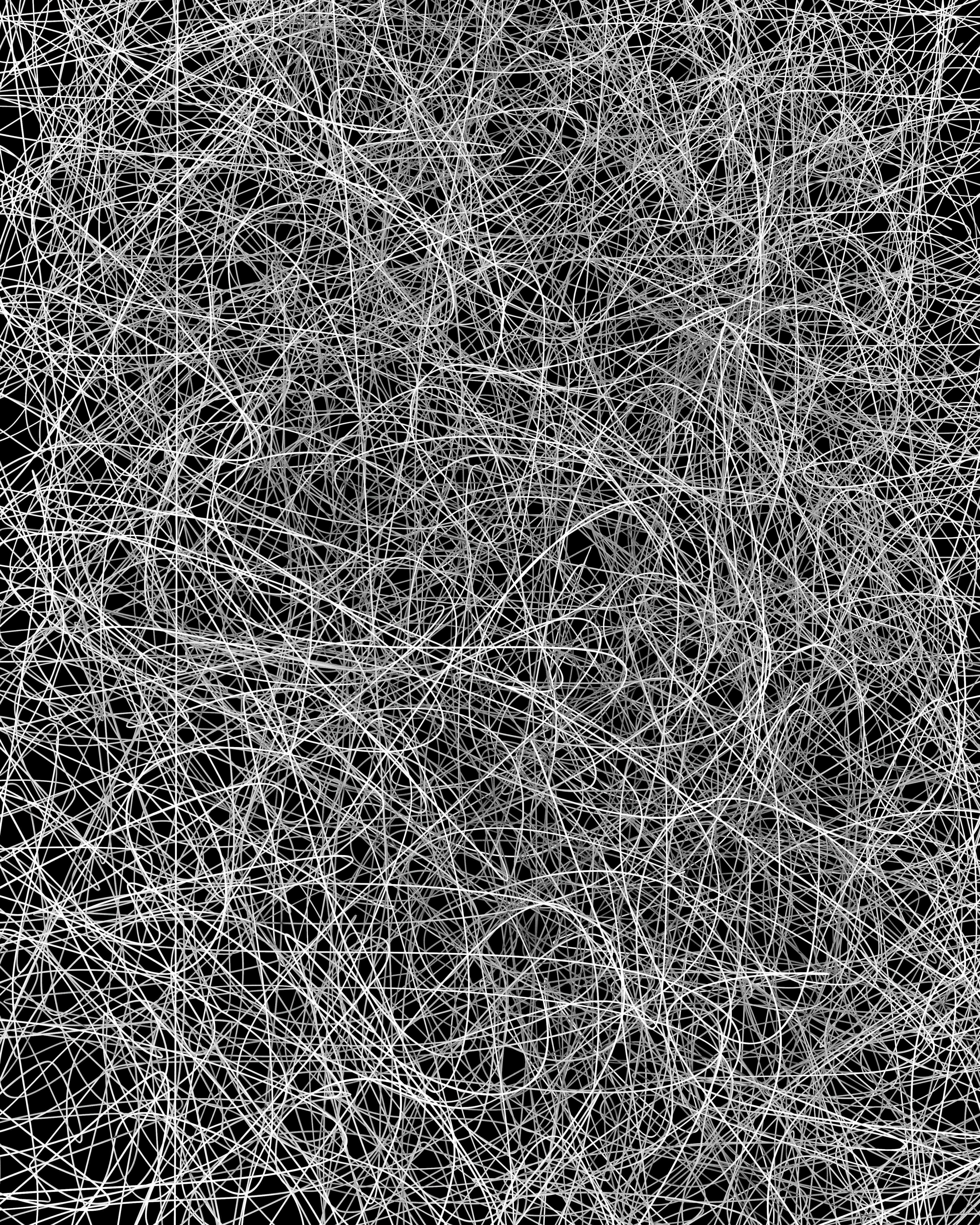Ce que vous allez retenir
Pourquoi la VaR a échoué en 2008 : elle ignorait les interconnexions entre institutions
Ce qu'est la CoVaR : un outil qui mesure la contagion financière systémique
Comment elle aurait pu prévenir la crise : en détectant la fragilité avant l'effondrement de Lehman Brothers
Ses applications actuelles : identification des banques systémiques et amélioration des stress tests
Ses limites : dépendance aux données passées et difficulté face aux nouveaux risques
Un choc historique qui a changé la perception du risque
L’année 2008 restera gravée dans la mémoire économique mondiale comme le moment où le système financier s’est approché du point de rupture. Ce qui avait commencé par des défauts de remboursement sur des prêts hypothécaires américains (les fameux subprimes) s’est transformé en crise systémique mondiale.
Des institutions financières réputées solides, comme Lehman Brothers, AIG ou Merrill Lynch, se sont effondrées ou ont dû être sauvées in extremis. Les marchés interbancaires se sont figés, les liquidités ont disparu et les gouvernements ont dû injecter des milliards pour éviter l’effondrement total du système.
Mais ce qui a le plus surpris les régulateurs, c’est la vitesse et l’ampleur de la contagion. Des banques pourtant situées dans des pays différents, avec des modèles économiques distincts, se sont retrouvées prises dans la même spirale de pertes. C’est dans ce contexte que les économistes ont réalisé que les outils classiques, comme la Value at Risk (VaR), ne suffisaient pas à prévoir ni à mesurer le risque systémique.
La limite de la Value at Risk mise en évidence
Avant la crise, la plupart des institutions financières utilisaient la VaR pour évaluer leur exposition au risque de marché. Cet indicateur semblait rassurant : les pertes extrêmes apparaissaient peu probables, et les modèles suggéraient que la probabilité d’une crise globale était quasi nulle.
Pourtant, en 2008, tous ces modèles se sont effondrés. La VaR mesurait correctement le risque individuel d’une banque, mais elle ignorait les liens invisibles entre acteurs. Autrement dit, chaque institution semblait saine prise isolément, alors que le système dans son ensemble était fragile.
Prenons une image simple : un immeuble peut sembler solide si l’on regarde chaque pilier séparément, mais si tous reposent sur la même fondation fissurée, l’ensemble s’effondre. La crise de 2008 a montré que le système financier mondial reposait justement sur une fondation commune : la dépendance excessive aux mêmes produits financiers (titrisations, CDO, dérivés de crédit) et aux mêmes sources de financement court terme.
C’est de ce constat qu’est née la nécessité d’un indicateur capable de mesurer la contagion et l’interdépendance entre institutions : la Co-Value at Risk (CoVaR).
L’émergence de la CoVaR après 2008
En 2011, Tobias Adrian (Réserve fédérale de New York) et Markus Brunnermeier (Université de Princeton) ont proposé la CoVaR comme un outil complémentaire à la VaR. Leur objectif était de pouvoir répondre à une question que la crise avait rendue incontournable : Que se passe-t-il pour le système financier si une seule grande institution entre en détresse ?
La CoVaR permet d’évaluer le risque du système conditionné à la situation d’une institution donnée. Autrement dit, elle mesure combien de pertes le système pourrait subir si, par exemple, la banque A venait à être en crise.
Le concept est simple, mais la portée est immense : il permet d’identifier les acteurs dont la défaillance amplifierait le risque global — autrement dit, les véritables « noeuds systémiques » du réseau financier.
Application rétrospective : ce qu’aurait montré la CoVaR avant 2008
Les travaux menés après la crise ont permis de reconstruire les CoVaR des grandes banques américaines et européennes sur la période 2003–2008. Les résultats sont frappants.
Avant 2007, la CoVaR des grandes banques d’investissement américaines (Lehman Brothers, Goldman Sachs, Morgan Stanley) était déjà en hausse, bien que la VaR individuelle restât stable. Cela indiquait que le risque collectif augmentait, même si chaque banque semblait individuellement prudente.
En 2007–2008, la CoVaR s’est envolée, reflétant la montée en flèche des corrélations entre institutions. Quand Lehman Brothers a vacillé, la CoVaR du système a bondi, signalant que le stress d’une seule banque pouvait entraîner tout le réseau.
Les assureurs et fonds de pension présentaient également une hausse de CoVaR, montrant que la contagion ne se limitait pas au secteur bancaire. Les produits dérivés et les contreparties financières ont joué le rôle de canaux de transmission.
En clair, si la CoVaR avait été utilisée avant la crise, elle aurait pu alerter les régulateurs sur la fragilité croissante du système, même quand les indicateurs classiques restaient au vert.
Ce que la crise de 2008 a révélé sur la contagion financière
La CoVaR éclaire plusieurs mécanismes de contagion observés durant la crise.
Effet de réseau : les institutions financières sont liées par des prêts, des dérivés, et des engagements croisés. La défaillance d’un acteur entraîne des pertes en cascade chez les autres.
Effet de liquidité : lorsque les marchés se sont figés, les banques ont été contraintes de vendre massivement leurs actifs pour obtenir du cash. Ces ventes forcées ont fait chuter les prix, amplifiant les pertes pour tout le monde.
Effet de confiance : la perception du risque s’est propagée aussi vite que les pertes réelles. Les investisseurs ont cessé de faire confiance aux bilans bancaires, accélérant la panique.
Ces dynamiques sont précisément celles que la CoVaR vise à mesurer : comment le stress d’un acteur donné se transmet et s’amplifie dans le reste du système.
Les apports concrets de la CoVaR dans la régulation post-crise
Depuis 2011, la CoVaR a inspiré plusieurs réformes dans la régulation financière internationale. Elle a notamment contribué à :
Identifier les institutions systémiques mondiales (G-SIBs) : le Conseil de stabilité financière (FSB) utilise des indicateurs proches de la CoVaR pour classer les banques selon leur importance systémique. Ces institutions doivent détenir plus de fonds propres pour compenser leur impact potentiel.
Améliorer les tests de résistance (stress tests) : les banques centrales, comme la BCE ou la Fed, intègrent désormais des scénarios où le choc d’une institution spécifique est simulé pour mesurer ses effets sur le système entier.
Renforcer la coordination entre régulateurs : la CoVaR souligne que le risque systémique dépasse les frontières nationales. Les régulateurs ont donc renforcé la coopération internationale à travers le Comité de Bâle et le FSB.
Favoriser la transparence des interconnexions : les banques doivent désormais déclarer davantage d’informations sur leurs contreparties et expositions croisées, afin de mieux cartographier le risque collectif.
Ce que la CoVaR aurait changé si elle avait existé en 2008
Si les régulateurs avaient disposé de la CoVaR avant la crise, plusieurs points auraient pu être anticipés :
Le rôle central de Lehman Brothers : la CoVaR aurait révélé que sa défaillance potentielle représentait une menace systémique majeure, justifiant une intervention plus précoce.
La fragilité du marché interbancaire : les liens de financement entre banques auraient été identifiés comme points de vulnérabilité structurelle.
La corrélation cachée des portefeuilles : les modèles de VaR supposaient que les pertes étaient indépendantes, alors que la CoVaR aurait mis en évidence des chocs synchronisés entre actifs.
En d’autres termes, la CoVaR aurait pu servir d’alerte avancée — un signal que le système devenait instable avant même que la crise n’explose.
Les limites de la CoVaR dans la pratique
Malgré sa pertinence, la CoVaR ne règle pas tout. Elle reste un modèle statistique qui dépend :
de la qualité des données financières (souvent incomplètes ou retardées),
des hypothèses de corrélation entre institutions,
et du choix du niveau de confiance utilisé pour calculer les pertes extrêmes.
De plus, la CoVaR mesure la contagion ex post — elle révèle des relations basées sur les données passées. En période d’innovation financière rapide, les canaux de contagion peuvent apparaître dans des zones non surveillées (cryptoactifs, finance décentralisée, etc.). Ainsi, la CoVaR doit être vue comme un outil d’aide à la décision, pas comme une garantie contre les crises.
Conclusion : un outil né des erreurs du passé
La Co-Value at Risk est née de l’expérience douloureuse de 2008. Elle incarne la prise de conscience que le risque ne réside pas seulement dans les pertes individuelles, mais dans les liens entre acteurs.
La crise des subprimes a prouvé qu’un système complexe peut être vulnérable même quand chacun de ses éléments paraît solide.
En intégrant cette dimension systémique, la CoVaR a profondément transformé la manière dont les régulateurs et les économistes perçoivent la stabilité financière. Elle a permis de passer d’une logique de gestion du risque isolé à une approche de gestion du risque collectif.
La CoVaR n’empêche pas les crises, mais elle offre un regard plus lucide sur la structure des interdépendances qui les alimentent. C’est un héritage direct de 2008 et un garde-fou indispensable pour tenter d’éviter la répétition de tels chocs à l’avenir.